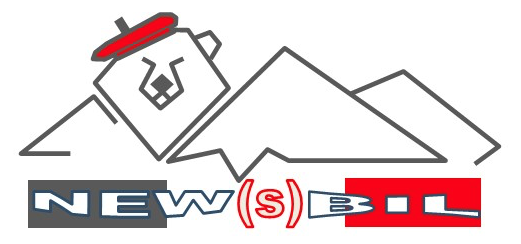

Âge, salaire, formation, sexe.... le nouveau profil type des grands patrons
En 1991, les grands patrons avaient de grands bureaux, pratiquaient l’entre-soi et bredouillaient trois mots d’anglais. Depuis, ils se sont convertis à la globalisation numérisée. Deux mondes différents.
Cet article est issu du magazine Capital
Quand il a été nommé à la direction générale de Suez en mai 2019, Bertrand Camus, 52 ans alors, a revu de fond en comble la déco de son bureau. Son prédécesseur, Jean-Louis Chaussade, à 67 ans, avait des goûts un brin datés, «lambris et canapés Chesterfield, se souvient le nouveau chef, une ambiance un peu trop solennelle». Sobre et plus contemporain, l’espace est à présent décoré de trois grands tirages du photographe de fonds marins Nicolas Floc’h. Une autre image, signée du plasticien béninois Romuald Hazoumè, montre un homme juché sur une moto fatiguée, transportant des bidons d’essence de contrebande entre deux pays d’Afrique. Une vraie galerie d’art…
Le bureau comme symbole du pouvoir… Ce fut longtemps le péché mignon des patrons. Ils exigeaient d’avoir le plus grand, le plus haut dans les étages et recevaient porte fermée (et capitonnée). Olivier Wigniolle, le directeur de la foncière Icade, en a aménagé beaucoup et a pu y observer l’évolution des mœurs. «Les grands patrons n’ont plus besoin de ça pour installer leur image. C’était très différent quand j’ai démarré en 1990.»
Ce n’est pas le moindre des changements entre le style des dirigeants d’il y a trente ans, au moment où Capital publiait son premier numéro, et celui des présidents et CEOs d’aujourd’hui. Les plus audacieux pratiquent maintenant le flex office. Pour eux, fini le bureau attitré. Carlos Tavares, aux commandes de Stellantis (né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler), est l’un des pionniers du genre. «Il travaille beaucoup depuis le Portugal et son domicile de Rambouillet (78)», explique un proche collaborateur. Alexandre Ricard, le roi des spiritueux, n’a plus de place attitrée et range ses affaires dans un casier, comme les autres. Plutôt de la vieille école, Frédéric Oudéa, le DG de Société générale, s’y est mis lui aussi. Il s’apprête à inaugurer un nouvel immeuble à Val-de-Fontenay (94), où le bureau nomade sera la règle.
Autres temps, autres mœurs, donc. Il faut dire qu’en trente ans, le rôle même des grands patrons a profondément changé. Au début des années 1990, quel était le paysage? Des dirigeants en pleine ascension comme Bernard Arnault chez LVMH, François Pinault chez PPR (devenu Kering), ou Vincent Bolloré (propriétaire de Vivendi et Prisma Media, l’éditeur de Capital), des entrepreneurs au flair redoutable, faisaient fructifier un vieux capitalisme d’héritage.
D’autres, souvent polytechniciens ou énarques (voire les deux), passés par des cabinets ministériels, dirigeaient de grands groupes forts de leurs relations dans les hautes sphères de l’Etat. A l’image entre autres de Jérôme Monod, président de la Lyonnaise des eaux de 1980 à 1997, ex-secrétaire général du RPR et proche de Jacques Chirac, ou de Jacques Calvet, ancien directeur de cabinet de Valéry Giscard d’Estaing, patron de la BNP, puis de PSA Peugeot-Citroën de 1984 à 1997.
Une troisième famille réunissait des dirigeants qui, sans être propriétaires, se comportaient tout comme. Parmi ces «conquérants»: Henri Lachmann, patron de Strafor-Facom puis de Schneider Electric, Maurice Lévy, le lion de Publicis, et surtout Claude Bébéar, bâtisseur de l’empire d’assurances Axa, qu’il a présidé de 1985 aux années 2000. Alors considéré comme un «parrain» du monde des affaires – rôle aussi attribué au plus discret banquier de BNP Paribas Michel Pébereau –, Bébéar avait notamment joué un rôle clé dans la chute en 2002 de Jean-Marie Messier, alors P-DG de Vivendi Universal, dont il critiquait la stratégie alors qu’il n’avait aucun mandat dans l’entreprise. En cela, il était le digne héritier d’Ambroise Roux, ancien patron de la CGE (futur Alcatel) et fondateur de l’Afep (Association française des entreprises privées), qui a tiré les ficelles en coulisses pendant des années pour façonner le paysage industriel de l’Hexagone.
Epoque révolue, assure un communicant qui murmure à l’oreille des big boss du CAC 40: «Aujourd’hui, les parrains et les faiseurs de rois ont disparu. Les patrons ont tellement à faire dans leur propre boîte qu’ils n’ont pas le temps de s’occuper des autres.» De même, l’Etat a perdu de son influence. «Le cordon ombilical avec le monde politique a été rompu», estime Vincent de La Vaissière, fondateur du cabinet VcomV qui produit chaque année une étude fouillée sur l’image des grands patrons. Le dernier transfert en date s’est d’ailleurs traduit par un échec: programmé pour devenir en 2022 le directeur général de Scor, l’entreprise de réassurance présidée par Denis Kessler, Benoît Ribadeau-Dumas, ex-directeur de cabinet d’Edouard Phillipe, a finalement été désavoué par le conseil d’administration, en mai dernier. Manque de légitimité…
Nos dirigeants n’ont pas seulement abandonné les bannettes, les fax et les parapheurs de leurs bureaux Empire. Dans une économie globalisée et numérisée, ils ont aussi élargi leur champ de vision. Avec la chute du mur de Berlin, en 1989, le monde entier est devenu accessible pour faire du business. Une nouvelle grammaire des affaires s’est imposée, truffée de concepts anglo-saxons: Ebitda, bottom line, asset light, private equity… Ah, l’anglais! Il y a trente ans, nos capitaines d’industrie le maniaient avec difficulté, voire pas du tout. Et pour cause, nombre d’entre eux n’avaient pas travaillé à l’étranger. «Quand je suis entré chez Saint-Gobain en 1990, Jean-Louis Beffa était aux commandes et il n’avait jamais été expatrié», se souvient de son côté Pierre-André de Chalendar, le président du groupe qui a occupé plusieurs postes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne avant d’accéder à la direction générale.
Aujourd’hui, diriger une grande entreprise sans avoir vu du pays est difficilement envisageable. Un Camus (aujourd’hui sur le départ de Suez) a passé trois ans en Malaisie, six en Argentine, sept aux Etats-Unis. Certains poussent d’ailleurs loin la logique. Comme Jean-Pascal Tricoire, P-DG de Schneider Electric, qui manage l’entreprise depuis Hong Kong et dont le comex est éparpillé aux quatre coins du globe. Prolongeant cette logique, le CAC 40 a ouvert ses portes aux patrons étrangers. Derniers exemples en date, l’Anglais Paul Hudson chez Sanofi, l’Italien Luca de Meo à la tête du groupe Renault ou encore, schéma impensable il y a quelques années, le canadien Benjamin Smith, pilote en chef d’Air France-KLM.
En même temps que le terrain de jeu des grands patrons s’élargissait, de nouveaux principes de management ont commencé à s’imposer. «L’aptitude à travailler en commun est devenue de plus en plus nécessaire, la collégialité est devenue indispensable dès lors qu’il s’est agi de faire collaborer toutes les nationalités ensemble», explique Jacques Aschenbroich, le P-DG de l’équipementier automobile Valeo. Les «patrons de droit divin» enfermés dans leur tour d’ivoire et pétris de certitudes n’ont plus cours. Les chasseurs de têtes écartent même ce genre d’ego de leurs castings. «On sait que tout peut basculer du jour au lendemain. Un patron doit donc être capable de penser sous forme de scénario et, s’il ne doute pas, il n’est pas jugé favorablement par les recruteurs», explique Hervé Borensztejn, associé chez Heidrick & Struggles.
Autre fait notable, le patron 2.0 ne décide plus seul, ni sans un minimum de transparence. Les conseils d’administration ont cessé d’être des chambres d’enregistrement. «Les administrateurs posent de plus en plus de questions et challengent le conseil. Ils sont bien plus présents qu’il y a trente ans», confirme Pierre-André de Chalendar. C’est encore plus vrai dans les sociétés à la gouvernance dissociée entre un président et un directeur général (65% des boîtes du CAC 40 au dernier pointage): ce dernier s’y trouve de plus en plus souvent assis sur un siège très éjectable. Christopher Viehbacher, le DG de Sanofi, l’a vécu en 2014, Isabelle Kocher, directrice d’Engie, en 2020. La pression des marchés et, ces dernières années, des fonds activistes oblige également les patrons à fournir leurs prévisions chaque trimestre avec une prudence de Sioux. Et gare si les investisseurs n’achètent pas leur récit. Emmanuel Faber chez Danone, congédié manu militari par le conseil en mars dernier, en a fait l’expérience.
Prônant en haut de sa tour, ou dans les beaux quartiers de l’ouest parisien, le président du XXe siècle finissant pensait l’entreprise de façon verticale. Avec lui au sommet de la pyramide. Aujourd’hui, les grands groupes sont beaucoup plus «flat», organisés de façon plus horizontale. Le numérique est passé par là, qui donne plus d’autonomie aux cadres dirigeants tout en permettant un contrôle étroit de leur activité. «L’une des conséquences, c’est que l’on ne donne plus d’ordres.
Avant, un jeune cadre récemment embauché écoutait son supérieur pour savoir ce qu’il devait faire. Aujourd’hui, on recrute des stagiaires qui ne vont même pas demander à leur chef la marche à suivre, ils s’adressent directement par e-mail aux personnes qui ont l’information. C’est très déstabilisant!», confesse Pierre-André de Chalendar. Les outils digitaux ont aussi profondément modifié la communication interne. Une fois installé à la tête de Stellantis, Carlos Tavares n’a pas renoncé aux «business reviews» mensuelles auxquelles il avait habitué ses équipes chez PSA. Sauf qu’elles ont lieu désormais dans une salle virtuelle, avec des participants disséminés entre la France, l’Italie, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Brésil.
Tous les dirigeants interrogés le reconnaissent: le job est devenu bien plus complexe que par le passé. «Le patron est au centre de toutes les contradictions, coincé entre les souhaits des actionnaires et ceux des clients, des syndicats, des Etats, de la société…», énumère Jacques Aschenbroich. A cela s’ajoute pour certains la fragmentation du marché mondial, liée au bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis et qui complique le choix des partenaires. «Ils sont sur le pont 24 heures sur 24, la pression sur l’entreprise vient de tous les côtés avec de nouveaux sujets très surveillés par les investisseurs, comme la politique environnementale», souligne Sylvain Dhenin, associé chez Heidrick & Struggles. «Aujourd’hui, pour diriger une grande entreprise, il faut être un sportif de haut niveau bon en sprint comme en endurance!»
La mission est plus complexe, plus risquée aussi, mais elle est beaucoup mieux payée que par le passé. L’explosion de la rémunération des patrons fait d’ailleurs de plus en plus débat. Dans les années 1990, c’était simple, leur fiche de paie était secrète. La divulgation du salaire de Jacques Calvet dans «Le Canard enchaîné» avait fait scandale. Et pourtant, il ne s’élevait qu’à 2,2 millions de francs. Ridicule, par rapport aux 5,2 millions d’euros annuels empochés en moyenne par les patrons du CAC 40 en 2019 selon les calculs du cabinet Proxinvest. «Cela représente l’équivalent de 138 fois le salaire moyen des Français, ou encore 248 Smic», indique Loïc Dessaint, expert en gouvernance du même cabinet. Voilà qui vaut bien de mouiller la chemise.
Le profil type des patrons des sociétés cotées
1991 : un patronat « vieille France »
Le patronat du début des années 1990 est encore très connoté «vieille France» (exemple : Claude Bébéar d'Axa). Les X et les énarques sont surreprésentés, l’entre-soi et la cooptation à la tête des grandes sociétés sont de mise. A l’époque, les revenus des dirigeants ne sont pas publics… mais beaucoup plus raisonnables qu’aujourd’hui.
Age moyen : 56 ans
Sexe : 100% masculin
A fait une des écoles d’élite : 79%
Expérience internationale : 30%
De nationalité étrangère : 4%
Ancienneté dans le poste : 9 ans
Rémunération moyenne : 33 Smic
2021 : l'âge a diminué
L’âge pour accéder à la fonction suprême a diminué (exemple : Xavier Niel de Free), l’ère du numérique y contribue. Plus international, le patron est bien mieux payé, mais lorsqu’il n’est pas le fondateur, son règne est écourté.
Age moyen : 49 ans
Sexe : 97% masculin
A fait une des écoles d’élite : 63%
Expérience internationale : 50%
De nationalité étrangère : 10%
Ancienneté dans le poste : 4 ans
Rémunération moyenne : 248 Smic
Trois décennies ont modifié le profil des dirigeants : des bâtisseurs aux globe-trotteurs
Il y a un avant et un après 1989. La chute du mur de Berlin, suivie de la globalisation de l’économie, a entraîné un mouvement de plaques tectoniques comme les entreprises françaises n’en avaient jamais connu auparavant. Profond, l’impact de ce phénomène sur le profil des dirigeants et sur les modes de management s’est opéré par vagues successives, il conditionne toujours leur manière de fonctionner.
1989-1999. Les premiers patrons à se lancer dans la mondialisation
Après la chute du mur en 1989, les entreprises françaises commencent à sortir des frontières à marche forcée: Amérique latine, Chine… Parmi ces sociétés, Danone, dirigé par Antoine Riboud puis son fils Franck, met les bouchées doubles. Alors à la tête de Carrefour, Daniel Bernard fera de même dans le domaine en plein boom de la grande distribution.
1993-2005. Le capitalisme familial renforce ses positions
A partir de 1993, le groupe LVMH de Bernard Arnault se développe par croissance externe et devient un incontournable géant du luxe, au point de faire aujourd’hui de son dirigeant l’un des hommes les plus riches du monde. François Pinault, patron du groupe familial PPR (rebaptisé Kering), le défie en se lançant lui aussi dans le luxe à la fin des années 1990.
2002-2010. L’ère des financiers tourne au vinaigre
Polytechnicien, énarque, inspecteur des finances passé par les cabinets ministériels, puis banquier d’affaires chez Lazard, Jean-Marie Messier incarne l’époque des patrons financiers à la tête de grandes entreprises. Sa chute, en 2002, sera retentissante. L’aura de ses pairs se ternira un peu plus avec le krach boursier de 2008.
2009-2021. La consécration des dirigeants internationaux
Alors qu’il y a quinze ans le marché français représentait 70% du chiffre d’affaires d’une entreprise comme Alstom, Schneider Electric en réalise un tiers aux Etats-Unis, un tiers en Asie et un tiers en Europe. Son patron, Jean-Pascal Tricoire, est l’archétype du nouveau patron français, systématiquement doté d’une solide expérience de postes à l’étranger.
Le patron d’aujourd’hui doit avoir l’endurance d’un sportif de haut niveau.
Les femmes à la tête des grandes entreprises : la France a toujours du retard
Combien de femmes à la direction des sociétés du CAC 40 ? Seulement une : Catherine MacGregor, 49 ans, directrice générale d’Engie. Ses consœurs sont plus nombreuses aux manettes de boîtes du SBF 120, plus petites, mais elles ne sont pas légion. Pourquoi ce plafond de verre? Les dirigeants en place invoquent souvent le problème du «vivier»: les écoles d’ingénieurs, où beaucoup d’entreprises françaises puisent leurs futurs talents, n’accueillent que 20 à 25% de femmes.
Professeur à la faculté de management de l’Université de Genève et membre du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, Michel Ferrary y voit surtout les effets d’une «discrimination inconsciente»: les patrons s’entourent de gens qui leur ressemblent. Pour y remédier, la loi va imposer 40% de femmes dans les comex d’ici à 2040.


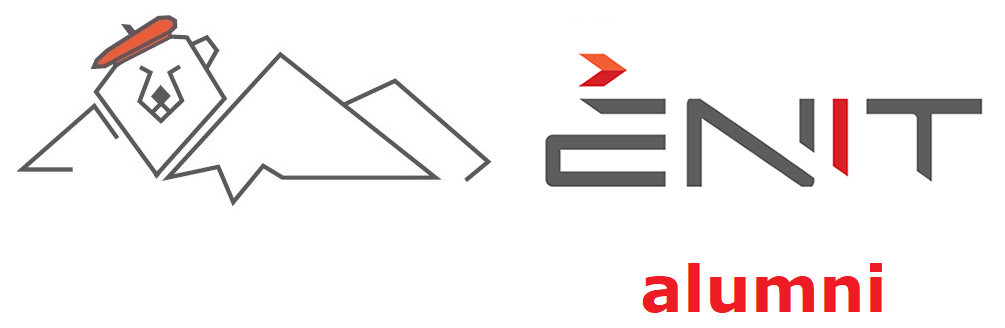





















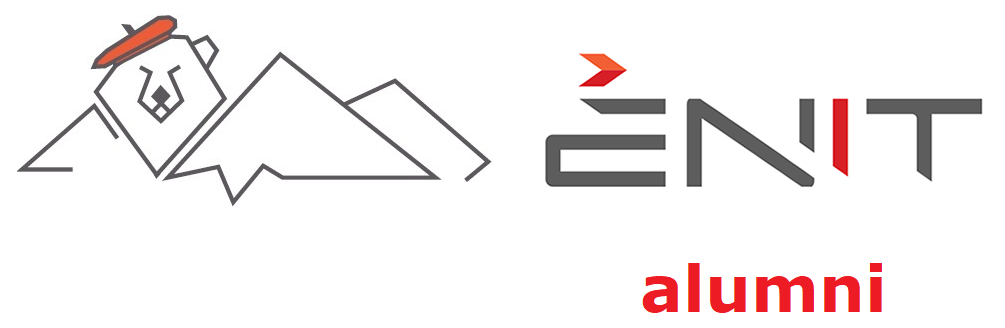

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.